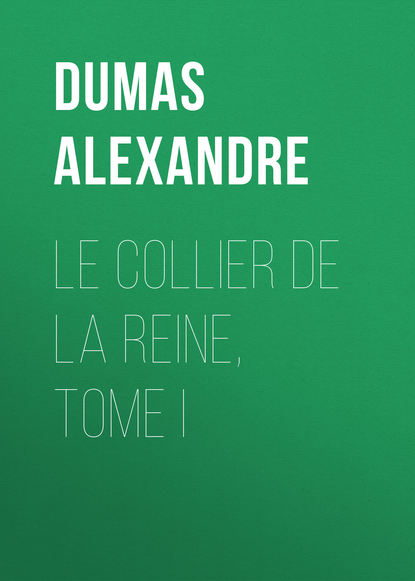По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Le Collier de la Reine, Tome I
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– On peut les trouver. Pour le reste?
– Votre Éminence voudrait du temps? dit Bœhmer. Avec la garantie de Votre Éminence, tout est faisable. Seulement, le retard implique une perte; car, notez bien ceci, monseigneur: dans une affaire de cette importance, les chiffres grossissent d'eux-mêmes sans raison. Les intérêts de quinze cent mille livres font, au denier cinq, soixante-quinze mille livres, et le denier cinq est une ruine pour les marchands. Dix pour cent sont tout au plus le taux acceptable.
– Ce serait cent cinquante mille livres, à votre compte?
– Mais, oui, monseigneur.
– Mettons que vous vendez le collier seize cent mille livres, monsieur Bœhmer, et divisez le paiement de quinze cent mille livres qui resteront en trois échéances complétant une année. Est-ce dit?
– Monseigneur, nous perdons cinquante mille livres à ce marché.
– Je ne crois pas, monsieur. Si vous aviez à toucher demain quinze cent mille livres, vous seriez embarrassé: un joaillier n'achète pas une terre de ce prix-là.
– Nous sommes deux, monseigneur, mon associé et moi.
– Je le veux bien, mais n'importe, et vous serez bien plus à l'aise de toucher cinq cent mille livres chaque tiers d'année, c'est-à-dire deux cent cinquante mille livres chacun.
– Monseigneur oublie que ces diamants ne nous appartiennent pas. Oh! s'ils nous appartenaient, nous serions assez riches pour ne nous inquiéter ni du paiement, ni du placement à la rentrée des fonds.
– À qui donc appartiennent-ils alors?
– Mais, à dix créanciers peut-être: nous avons acheté ces pierres en détail. Nous les devons l'une à Hambourg, l'autre à Naples; une à Buenos-Ayres, deux à Moscou. Nos créanciers attendent la vente du collier pour être remboursés. Le bénéfice que nous ferons fait notre seule propriété; mais, hélas! monseigneur, depuis que ce malheureux collier est en vente, c'est-à-dire depuis deux ans, nous perdons déjà deux cent mille livres d'intérêt. Jugez si nous sommes en bénéfice.
Monsieur de Rohan interrompit Bœhmer.
– Avec tout cela, dit-il, je ne l'ai pas vu, moi, ce collier.
– C'est vrai, monseigneur, le voici.
Et Bœhmer, après toutes les précautions d'usage, exhiba le précieux joyau.
– Superbe! s'écria le cardinal en touchant avec amour les fermoirs qui avaient dû s'imprimer sur le col de la reine.
Quand il eut fini et que ses doigts eurent à satiété cherché sur les pierres les effluves sympathiques qui pouvaient lui être demeurées adhérentes:
– Marché conclu? dit-il.
– Oui, monseigneur; et de ce pas, je m'en vais à l'ambassade pour me dédire.
– Je ne croyais pas qu'il y eût d'ambassadeur du Portugal à Paris en ce moment?
– En effet, monseigneur, monsieur de Souza s'y trouve en ce moment; il est venu incognito.
– Pour traiter l'affaire, dit le cardinal en riant.
– Oui, monseigneur.
– Oh! pauvre Souza! Je le connais beaucoup. Pauvre Souza!
Et il redoubla d'hilarité.
Monsieur Bœhmer crut devoir s'associer à la gaieté de son client. On s'égaya longtemps sur cet écrin, aux dépens du Portugal.
Monsieur de Rohan allait partir.
Bœhmer l'arrêta.
– Monseigneur veut-il me dire comment se réglera l'affaire? demanda-t-il.
– Mais tout naturellement.
– L'intendant de monseigneur?
– Non pas; personne excepté moi; vous n'aurez affaire qu'à moi.
– Et quand?
– Dès demain.
– Les cent mille livres?
– Je les apporterai ici demain.
– Oui, monseigneur. Et les effets?
– Je les souscrirai ici demain.
– C'est au mieux, monseigneur.
– Et puisque vous êtes un homme de secret, monsieur Bœhmer, souvenez-vous bien que vous en tenez dans vos mains un des plus importants.
– Monseigneur, je le sens, et je mériterai votre confiance, ainsi que celle de Sa Majesté la reine, ajouta-t-il finement.
Monsieur de Rohan rougit et sortit troublé, mais heureux comme tout homme qui se ruine dans un paroxysme de passion.
Le lendemain de ce jour, monsieur Bœhmer se dirigea d'un air composé vers l'ambassade de Portugal.
Au moment où il allait frapper à la porte, monsieur Beausire, premier secrétaire, se faisait rendre des comptes par monsieur Ducorneau, premier chancelier, et don Manoël y Souza, l'ambassadeur, expliquait un nouveau plan de campagne à son associé, le valet de chambre.
Depuis la dernière visite de monsieur Bœhmer à la rue de la Jussienne, l'hôtel avait subi beaucoup de transformations.
Tout le personnel débarqué, comme nous l'avons vu, dans les deux voitures de poste, s'était casé selon les exigences du besoin, et dans les attributions diverses qu'il devait remplir dans la maison du nouvel ambassadeur.
Il faut dire que les associés, en se partageant les rôles qu'ils remplissaient admirablement bien, devant les changer, avaient l'occasion de surveiller eux-mêmes leurs intérêts, ce qui donne toujours un peu de courage dans les plus pénibles besognes.
Monsieur Ducorneau, enchanté de l'intelligence de tous ces valets, admirait en même temps que l'ambassadeur se fût assez peu soucié du préjugé national pour prendre une maison entièrement française, depuis le premier secrétaire jusqu'au troisième valet de chambre.
Aussi ce fut à ce propos qu'en établissant les chiffres avec monsieur de Beausire, il entamait avec ce dernier une conversation pleine d'éloges pour le chef de l'ambassade.
– Votre Éminence voudrait du temps? dit Bœhmer. Avec la garantie de Votre Éminence, tout est faisable. Seulement, le retard implique une perte; car, notez bien ceci, monseigneur: dans une affaire de cette importance, les chiffres grossissent d'eux-mêmes sans raison. Les intérêts de quinze cent mille livres font, au denier cinq, soixante-quinze mille livres, et le denier cinq est une ruine pour les marchands. Dix pour cent sont tout au plus le taux acceptable.
– Ce serait cent cinquante mille livres, à votre compte?
– Mais, oui, monseigneur.
– Mettons que vous vendez le collier seize cent mille livres, monsieur Bœhmer, et divisez le paiement de quinze cent mille livres qui resteront en trois échéances complétant une année. Est-ce dit?
– Monseigneur, nous perdons cinquante mille livres à ce marché.
– Je ne crois pas, monsieur. Si vous aviez à toucher demain quinze cent mille livres, vous seriez embarrassé: un joaillier n'achète pas une terre de ce prix-là.
– Nous sommes deux, monseigneur, mon associé et moi.
– Je le veux bien, mais n'importe, et vous serez bien plus à l'aise de toucher cinq cent mille livres chaque tiers d'année, c'est-à-dire deux cent cinquante mille livres chacun.
– Monseigneur oublie que ces diamants ne nous appartiennent pas. Oh! s'ils nous appartenaient, nous serions assez riches pour ne nous inquiéter ni du paiement, ni du placement à la rentrée des fonds.
– À qui donc appartiennent-ils alors?
– Mais, à dix créanciers peut-être: nous avons acheté ces pierres en détail. Nous les devons l'une à Hambourg, l'autre à Naples; une à Buenos-Ayres, deux à Moscou. Nos créanciers attendent la vente du collier pour être remboursés. Le bénéfice que nous ferons fait notre seule propriété; mais, hélas! monseigneur, depuis que ce malheureux collier est en vente, c'est-à-dire depuis deux ans, nous perdons déjà deux cent mille livres d'intérêt. Jugez si nous sommes en bénéfice.
Monsieur de Rohan interrompit Bœhmer.
– Avec tout cela, dit-il, je ne l'ai pas vu, moi, ce collier.
– C'est vrai, monseigneur, le voici.
Et Bœhmer, après toutes les précautions d'usage, exhiba le précieux joyau.
– Superbe! s'écria le cardinal en touchant avec amour les fermoirs qui avaient dû s'imprimer sur le col de la reine.
Quand il eut fini et que ses doigts eurent à satiété cherché sur les pierres les effluves sympathiques qui pouvaient lui être demeurées adhérentes:
– Marché conclu? dit-il.
– Oui, monseigneur; et de ce pas, je m'en vais à l'ambassade pour me dédire.
– Je ne croyais pas qu'il y eût d'ambassadeur du Portugal à Paris en ce moment?
– En effet, monseigneur, monsieur de Souza s'y trouve en ce moment; il est venu incognito.
– Pour traiter l'affaire, dit le cardinal en riant.
– Oui, monseigneur.
– Oh! pauvre Souza! Je le connais beaucoup. Pauvre Souza!
Et il redoubla d'hilarité.
Monsieur Bœhmer crut devoir s'associer à la gaieté de son client. On s'égaya longtemps sur cet écrin, aux dépens du Portugal.
Monsieur de Rohan allait partir.
Bœhmer l'arrêta.
– Monseigneur veut-il me dire comment se réglera l'affaire? demanda-t-il.
– Mais tout naturellement.
– L'intendant de monseigneur?
– Non pas; personne excepté moi; vous n'aurez affaire qu'à moi.
– Et quand?
– Dès demain.
– Les cent mille livres?
– Je les apporterai ici demain.
– Oui, monseigneur. Et les effets?
– Je les souscrirai ici demain.
– C'est au mieux, monseigneur.
– Et puisque vous êtes un homme de secret, monsieur Bœhmer, souvenez-vous bien que vous en tenez dans vos mains un des plus importants.
– Monseigneur, je le sens, et je mériterai votre confiance, ainsi que celle de Sa Majesté la reine, ajouta-t-il finement.
Monsieur de Rohan rougit et sortit troublé, mais heureux comme tout homme qui se ruine dans un paroxysme de passion.
Le lendemain de ce jour, monsieur Bœhmer se dirigea d'un air composé vers l'ambassade de Portugal.
Au moment où il allait frapper à la porte, monsieur Beausire, premier secrétaire, se faisait rendre des comptes par monsieur Ducorneau, premier chancelier, et don Manoël y Souza, l'ambassadeur, expliquait un nouveau plan de campagne à son associé, le valet de chambre.
Depuis la dernière visite de monsieur Bœhmer à la rue de la Jussienne, l'hôtel avait subi beaucoup de transformations.
Tout le personnel débarqué, comme nous l'avons vu, dans les deux voitures de poste, s'était casé selon les exigences du besoin, et dans les attributions diverses qu'il devait remplir dans la maison du nouvel ambassadeur.
Il faut dire que les associés, en se partageant les rôles qu'ils remplissaient admirablement bien, devant les changer, avaient l'occasion de surveiller eux-mêmes leurs intérêts, ce qui donne toujours un peu de courage dans les plus pénibles besognes.
Monsieur Ducorneau, enchanté de l'intelligence de tous ces valets, admirait en même temps que l'ambassadeur se fût assez peu soucié du préjugé national pour prendre une maison entièrement française, depuis le premier secrétaire jusqu'au troisième valet de chambre.
Aussi ce fut à ce propos qu'en établissant les chiffres avec monsieur de Beausire, il entamait avec ce dernier une conversation pleine d'éloges pour le chef de l'ambassade.